 Après un premier rapport accablant et sans concessions en janvier 2011 sur l’affaire du Mediator, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a poursuivi la mission que lui avait confiée Xavier Bertrand : comprendre les dysfonctionnements de la pharmacovigilance française révélés ces derniers mois et faire des propositions pour l’avenir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce second rapport de l’IGAS, publié le 21 juin 2011, adopte un ton tout aussi critique à l’égard de l’industrie, des agences de santé gouvernementales et des politiques que le premier et que les propositions sont audacieuses. Y a-t-il de quoi se réjouir pour autant ? Pas nécessairement lorsque l’on connaît le sort réservé par les pouvoirs publics à bon nombre de rapports une fois que les effets d’annonce se sont estompés…
Après un premier rapport accablant et sans concessions en janvier 2011 sur l’affaire du Mediator, l’Inspection générale des affaires sociales (IGAS) a poursuivi la mission que lui avait confiée Xavier Bertrand : comprendre les dysfonctionnements de la pharmacovigilance française révélés ces derniers mois et faire des propositions pour l’avenir. Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce second rapport de l’IGAS, publié le 21 juin 2011, adopte un ton tout aussi critique à l’égard de l’industrie, des agences de santé gouvernementales et des politiques que le premier et que les propositions sont audacieuses. Y a-t-il de quoi se réjouir pour autant ? Pas nécessairement lorsque l’on connaît le sort réservé par les pouvoirs publics à bon nombre de rapports une fois que les effets d’annonce se sont estompés…
Concernant l’affaire du Mediator, l’IGAS persiste et signe. Quelques mois de recul n’y changent rien, l’IGAS réitère les conclusions de son rapport précédent : le benfluorex (Mediator) est bien un anorexigène (coupe-faim) ; le laboratoire Servier a, dès l’origine, « déployé une stratégie de positionnement du Mediator en décalage avec la réalité pharmacologique de ce médicament, utilisant tous les moyens à sa disposition pour faire prévaloir sa position » ; l’Agence chargée du médicament a été « incompréhensiblement tolérante à l’égard du Mediator et a fait preuve d’une grave défaillance dans les méthodes et l’organisation de son système de pharmacovigilance » ; les pouvoirs publics ont été trop lents à dérembourser ce médicament et globalement trop faibles dans leur pilotage de la « chaîne du médicament ». Pour l’IGAS, il ne faut pas se voiler la face : « Au-delà des anomalies particulières qu’elle a relevées, la mission tient à souligner que de graves défaillances globales des politiques et autorités publiques du médicament au général, du système français de pharmacovigilance au particulier […] existent et qu’elles résultent à la fois d’un affaiblissement du rôle de l’État depuis la fin des années 90, et d’un retard pris par rapport aux pays comparables. »
Les propositions pour faire évoluer ou pour réformer le système sont nombreuses. Simplifier les déclarations et apporter un retour concret aux déclarants sont au nombre de celles-ci. Déconnecter celui qui déclare, qu’il soit professionnel de santé ou patient, de l’industrie semble aussi important aux rapporteurs : « Au Royaume-Uni, un courrier d’accompagnement précise à la personne qui notifie qu’elle ne sera pas inquiétée. L’anonymat du notificateur et du patient doit être respecté ». Mais il faut aussi donner une véritable indépendance à l’Afssaps vis-à-vis de l’industrie en lui permettant de ne plus tenir compter de l’avis des fabricants quant à l’imputabilité de leurs produits dans la survenue d’un effet indésirable et en donnant les moyens à l’Agence de réaliser des méta-analyses indépendantes afin qu’elle « n’accorde plus aux analyses fournies par les laboratoires pharmaceutiques un poids prépondérant dans la prise des décisions ».
Développer des signaux d’alerte automatisés et repenser la doctrine du risque individuel, c’est aussi ce que propose l’Igas. « L’Afssaps pour l’heure conduit plutôt un raisonnement sur le risque individuel. Elle s’est comportée comme une agence des produits de santé qui va, à tous les temps, juger si un médicament mérite ou pas de demeurer sur le marché. C’est probablement cette logique qui aboutit à l’inversion de la charge de la preuve avec un doute qui profite souvent au médicament. Il lui faut désormais développer une culture d’analyse populationnelle du risque. » Procéder ainsi, c’est ternir compte du fait que « les données de sécurité d’emploi disponibles lors des autorisations de mise sur le marché [AMM, NDLR] sont par essence limitées du fait notamment du nombre de personnes concernées par les essais cliniques et de la sous-représentation de certains groupes de population (personnes âgées, enfants, etc.). Les effets indésirables observés lors des essais cliniques ne représentent donc pas réellement les réactions dans la population une fois l’AMM obtenue. Dès lors, il est indispensable de disposer de données de sécurité d’emploi post AMM. »
D’autres propositions sont faites par l’Igas comme, par exemple, de renforcer le niveau d’expertise interne de l’Afssaps en lui permettant de se constituer un noyau d’experts. Ce dernier comprendrait des spécialistes de pharmacovigilance, des cliniciens et des spécialistes de santé publique. Ces experts cesseraient tous liens d’intérêt avec l’industrie pharmaceutique dès qu’ils prennent leur fonction.
Pour l’Igas, il faut une politique du médicament globale, car il n’existe pas de véritable chaîne organisée du médicament actuellement. « L’Afssaps, chargée par la loi de l’évaluation et de la sécurité sanitaires, applique les indulgentes règles européennes d’autorisation de mise sur le marché et a progressivement relâché sa vigilance, faisant donc la part trop belle à l’offre industrielle, participant d’une politique d’encombrement thérapeutique, devenant au fil du temps une « agence enregistreuse » sur le modèle de l’agence européenne, l’EMA ; la Commission de la transparence, ne disposant ni des règles précises, ni des moyens de pratiquer une véritable évaluation médico-économique s’est trop longtemps contentée de reprendre les données issues de la commission d’AMM pour accorder de façon trop peu sélective les autorisations de remboursement ; le CEPS [Comité économique des produits de santé, NDLR] agit de façon isolée, sans contact réel et formalisé avec la Commission de la transparence, et fixe les prix des médicaments et sur des fondements discutables. »
Le constat est dur quant à la dérive qu’a connue le système de pharmacovigilance ces dernières années : « Dans le cas particulier du médicament, le projet d’éloigner la décision relative au médicament vers des agences autonomes, dotées de fortes compétences et que l’on concevait comme incorruptibles, afin de créer des lieux de résistance aux firmes plus forts que l’État, ce projet a échoué. La coupure entre le sanitaire et l’économique n’a pas diminué l’emprise des firmes, bien au contraire. La « dépolitisation » voulue de la décision n’a pas donné entière satisfaction, loin de là.
Le risque de « capture » du régulateur par les entreprises régulées s’est réalisé et, progressivement, une banalisation de l’Afssaps s’est opérée, aboutissant à ce constat dangereux : une agence de sécurité sanitaire non seulement n’inspirant plus la crainte, mais trop souvent entravée elle-même par la peur du recours juridique ; une agence fascinée et dominée par son « modèle », l’agence européenne. »
Il est aussi question de valeur thérapeutique ajoutée pour les nouveaux médicaments afin d’éviter un « encombrement thérapeutique ». « La mission réaffirme la logique d’un nombre suffisant de médicaments, logique s’opposant à l’idée d’une infinité de choix possible en matière de protection sociale, financièrement non accessible, paradoxalement inefficace et inéquitable, potentiellement dangereuse. »
L’Igas propose enfin une meilleure formation des jeunes médecins à ce qu’elle appelle « une médecine sobre », susceptible de privilégier autant les stratégies de santé non médicamenteuses que les médicamenteuses. Elle demande que la mascarade sur l’indépendance de la formation médicale continue vis-à-vis de l’industrie cesse et que de vraies réformes interviennent dans ce domaine.
Cerise sur le gâteau : « La mission estime qu’il n’y pas d’alternative à l’interdiction de la visite médicale comme les tentatives de régulation menées depuis quelques années l’ont montré. » Elle « propose l’affichage de toutes les contributions des firmes pharmaceutiques aux parties prenantes de la politique de santé, quelle qu’en soit la nature, sur le modèle du Sunshine Act américain » et insiste sur « le maintien d’une opposition absolue de notre pays dans le concert européen à toute amodiation des règles actuelles de non-promotion des médicaments vers le public ».
À quelques mois d’une élection présidentielle où la santé publique passe souvent bien après d’autres sujets et disparaît devant les intérêts des uns et des autres, on peut se demander qui pourrait avoir le courage de mener une telle réforme de la pharmacovigilance et de la politique du médicament sur la base de ces propositions qui n’ont rien de consensuel. Ces rapports de l’Igas ont le mérite de poser de vraies questions, mais y aura-t-il quelqu’un pour y répondre ?
 De nombreux parlementaires anglais ont décidé d’apporter leur soutien à un mouvement citoyen souhaitant qu’il soit interdit de fumer en voiture en présence d’un enfant dans l’habitacle, selon un article publié dans le BMJ.
De nombreux parlementaires anglais ont décidé d’apporter leur soutien à un mouvement citoyen souhaitant qu’il soit interdit de fumer en voiture en présence d’un enfant dans l’habitacle, selon un article publié dans le BMJ. Après
Après  La pharmacovigilance, selon l’article
La pharmacovigilance, selon l’article  La justice se fait moins docile aux politiques au fil du temps et la décision prise par la Cour de cassation, contre l’avis du parquet,
La justice se fait moins docile aux politiques au fil du temps et la décision prise par la Cour de cassation, contre l’avis du parquet,  Alors que l’affaire du Mediator bouleverse le landernau français, Ken Harvey, un médecin australien militant pour un marketing éthique des médicaments et autres produits pour la santé continue à être poursuivi en justice pour diffamation par la société commercialisant un produit amaigrissant, le SensaSlim, qu’il a osé critiquer sur Internet et dénoncer auprès des autorités sanitaires. La cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud a décidé, le 14 juin 2011, de le faire comparaître en août pour juger l’affaire au fond en refusant de rejeter de la plainte dont il fait l’objet. S’il est condamné, il risque une amende de 590 000 €.
Alors que l’affaire du Mediator bouleverse le landernau français, Ken Harvey, un médecin australien militant pour un marketing éthique des médicaments et autres produits pour la santé continue à être poursuivi en justice pour diffamation par la société commercialisant un produit amaigrissant, le SensaSlim, qu’il a osé critiquer sur Internet et dénoncer auprès des autorités sanitaires. La cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud a décidé, le 14 juin 2011, de le faire comparaître en août pour juger l’affaire au fond en refusant de rejeter de la plainte dont il fait l’objet. S’il est condamné, il risque une amende de 590 000 €. Pourquoi ne pas fermer l’accès direct aux services d’urgence à l’hôpital après 22 h ? C’est la question qu’a posée aux députés de son pays le ministre de la santé slovaque, Ivan Uhliarik, en leur soumettant un projet de loi
Pourquoi ne pas fermer l’accès direct aux services d’urgence à l’hôpital après 22 h ? C’est la question qu’a posée aux députés de son pays le ministre de la santé slovaque, Ivan Uhliarik, en leur soumettant un projet de loi  Qui aurait pu croire il y a encore quelques mois que les effets secondaires du Mediator affecteraient le président de la Haute Autorité de santé (HAS) ou, tout du moins, ses décisions ? Qui aurait pu imaginer que les « recommandations » de bonne pratique de cette instance officielle, imposées à tous les médecins dans un but d’uniformiser les dépenses de santé, sous couvert d’améliorer la qualité de la prise en charge en méprisant l’unicité de chaque patient, et reconnues par le Conseil d’État comme
Qui aurait pu croire il y a encore quelques mois que les effets secondaires du Mediator affecteraient le président de la Haute Autorité de santé (HAS) ou, tout du moins, ses décisions ? Qui aurait pu imaginer que les « recommandations » de bonne pratique de cette instance officielle, imposées à tous les médecins dans un but d’uniformiser les dépenses de santé, sous couvert d’améliorer la qualité de la prise en charge en méprisant l’unicité de chaque patient, et reconnues par le Conseil d’État comme 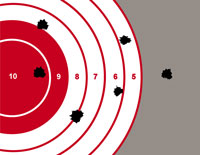 Ce ne sont pas moins de trois ministres, celui de l’intérieur, celui de la justice et celui de la santé, qui étaient réunis
Ce ne sont pas moins de trois ministres, celui de l’intérieur, celui de la justice et celui de la santé, qui étaient réunis  Alors que le
Alors que le  Nouvel épisode des transferts d’activités ou d’actes de soins entre professionnels de santé et de la réorganisation de leur intervention auprès du patient prévus par l’article 51 de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) devenu article
Nouvel épisode des transferts d’activités ou d’actes de soins entre professionnels de santé et de la réorganisation de leur intervention auprès du patient prévus par l’article 51 de la loi nº 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (HPST) devenu article